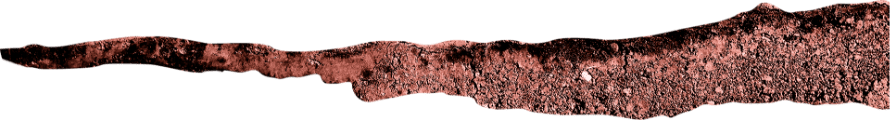
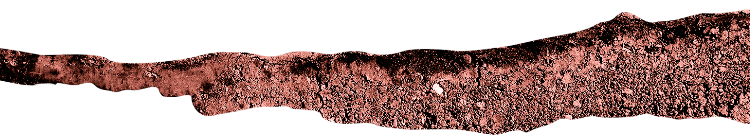

L’été, au Luxembourg comme ailleurs, étire ses journées sous un soleil de plomb. Mais si certains goûtent aux joies des terrasses ensoleillées ou des vacances au frais, d’autres vivent chaque vague de chaleur comme une épreuve. Dans un même quartier, le cadre supérieur profite de la climatisation de son bureau, tandis qu’à quelques rues de là un ouvrier de chantier suffoque sur l’asphalte brûlant. Les personnes âgées appréhendent le mercure qui grimpe, isolées dans des appartements surchauffés, alors que des familles plus aisées fuient la canicule en s’exilant vers des plages océanes. Sous la canicule, nos destins ne sont pas égaux : la chaleur estivale exacerbe les inégalités sociales et territoriales, révélant une véritable injustice climatique à l’œuvre. Accessible et paisible pour les uns, l’été peut devenir un fardeau accablant – une damnation – pour les autres.
Un révélateur d’inégalités climatiques
Les épisodes de canicule agissent comme un révélateur de nos fragilités sociales. Qui sont les « damnés de la chaleur » ? Avant tout, les personnes les plus vulnérables – aînés, jeunes enfants, malades, sans-abri – et plus largement celles qui cumulent les facteurs de fragilité. Une étude couvrant toute l’Europe a montré que les femmes et les personnes âgées paient le plus lourd tribut lors des étés caniculaires : en 2023, le taux de mortalité lié à la chaleur a été 55 % plus élevé chez les femmes que chez les hommes, et plus de sept fois plus élevé chez les plus de 80 ans comparé aux 65-79 ans. Ce constat s’explique par des réalités concrètes : les femmes vivent plus longtemps (souvent seules à un âge avancé) et les aînés souffrent de pathologies ou d’isolement qui rendent la chaleur mortelle. Au Luxembourg, on se souvient que la canicule européenne de 2003 avait particulièrement frappé le pays : +14,3 % de mortalité en août par rapport à la normale, faisant du Grand-Duché l’un des territoires proportionnellement les plus touchés. Plus récemment, l’été 2022 a également entraîné des dizaines de décès supplémentaires. La chaleur tue silencieusement, et ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent en première ligne.
Les inégalités socio-économiques aggravent encore ce bilan. Les personnes disposant de faibles revenus habitent souvent des logements mal isolés – appartements sous combles, immeubles vétustes sans ventilation adéquate – transformés en fournaises l’été venu. À l’inverse, les ménages aisés ont davantage accès à des habitations modernes avec isolation thermique, climatisation ou jardins ombragés. La rue, elle, ne pardonne pas : les personnes sans domicile fixe, privées d’abri frais, subissent de plein fouet les excès de chaleur. Or, comme le déplore le collectif “Solidaritéit mat den Heescherten”, le Plan Canicule luxembourgeois se concentre sur les personnes âgées isolées (via des inscriptions à la Croix-Rouge) et n’a prévu aucune mesure spécifique pour les sans-abri – ce soutien reposant essentiellement sur les actions bénévoles des ONG. Pas de distribution systématique d’eau, pas d’espaces ombragés dédiés : en 2025, alors que les records de température s’enchaînent, cette population demeure laissée pour compte de la fraîcheur. La canicule révèle ainsi une double injustice : ceux qui ont le moins contribué au changement climatique – précaires, exclus, personnes fragiles – en subissent le plus violemment les conséquences, sans toujours bénéficier des filets de sécurité suffisants.
Territoires sous haute température : disparités urbaines et rurales
La vulnérabilité face à la chaleur dépend aussi de la géographie. Un îlot de verdure à la campagne n’offre pas le même thermomètre qu’un canyon de béton en ville. Le Luxembourg, pays pourtant tempéré, voit émerger de fortes disparités territoriales sous l’effet du réchauffement. Les études menées par le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) confirment que les zones urbaines denses accumulent une chaleur bien supérieure à leurs environs. Dans le sud du pays, fortement urbanisé et marqué par le passé industriel, certaines communes subissent un effet d’îlot de chaleur urbain redoutable : faible végétation, forte densité bâtie, omniprésence de surfaces imperméables contribuent à des températures critiques atteignant parfois 46 °C au plus fort de l’été. Sans adaptation, ce bassin minier urbanisé (PRO-SUD) risque de devenir encore plus invivable à moyen terme, avec +0,7 à +2,7 °C supplémentaires attendus d’ici 2060. La carte ci-dessous illustre d’ailleurs les concentrations de chaleur repérées dans le pays . On y décèle clairement ces « points chauds » urbains, résultat de décennies d’urbanisme minéralisé.
À l’inverse, les secteurs ruraux ou boisés bénéficient la nuit d’un rafraîchissement bienvenu grâce aux sols naturels et aux courants d’air. Cette injustice climatique territoriale se manifeste même à l’échelle d’une ville : entre un quartier bétonné sans arbres et un parc ombragé, l’écart ressenti peut atteindre plusieurs degrés. « Un îlot de fraîcheur, c’est tout de suite 3 à 5 °C de moins ressentis », rappelle la députée Semiray Ahmedova. Ce différentiel est énorme – et vital – durant une canicule. Or pendant des années, l’urbanisme a privilégié le bitume et la voiture, reléguant au second plan la nature en ville. Les conséquences sont là : pavés et façades renvoyant la chaleur, absence d’arbres pour procurer de l’ombre, circulation d’air entravée par le bâti. Désormais, reverdir nos villes n’est plus un simple agrément esthétique, mais une urgence de santé publique. Le gouvernement luxembourgeois l’a bien compris en soutenant la renaturation des espaces urbains. En 2021, plus de 10 millions d’euros ont été investis pour encourager les communes à dé-imperméabiliser les sols et planter arbres, haies et jardins urbains. Chaque arbre planté, chaque mètre carré de pelouse ou de toiture végétale, est une petite victoire contre l’asphyxie estivale dans nos quartiers.
Travailler sous un soleil de plomb
Au zénith de juillet, tous les travailleurs ne sont pas égaux non plus face au thermomètre. Alors que certains employés de bureau peuvent s’abriter derrière les vitres teintées et la climatisation, beaucoup d’ouvriers, d’artisans ou d’agents publics restent exposés en extérieur ou dans des locaux insuffisamment refroidis. Le travail sous canicule devient un défi pour la santé. Lorsque la température frôle les 35 °C à l’ombre – niveau d’alerte orange activé par MeteoLux – les organismes souffrent, la productivité chute et le risque d’accident augmente. Les autorités luxembourgeoises, conscientes de l’enjeu, rappellent que l’employeur est responsable de la sécurité au travail en cas de chaleur extrême. L’Inspection du travail et des mines (ITM) publie ainsi des recommandations précises :
- Aménager des zones d’ombre ou des abris ventilés sur les chantiers.
- Fournir à chaque travailleur de l’eau potable en quantité suffisante (3 à 4 L par jour) et encourager à boire fréquemment.
- Réorganiser le travail pour éviter les tâches physiques intenses aux heures les plus chaudes, notamment près des surfaces métalliques ou goudronnées brûlantes.
- Adapter la tenue vestimentaire : casques couvrant la nuque, vêtements légers et clairs, lunettes de soleil et crème solaire.
- Isoler thermiquement les machines ou canalisations dégageant de la chaleur, ventiler les locaux, installer des ventilateurs ou des climatiseurs d’appoint si possible.
En dernier ressort, la loi prévoit même que les entreprises peuvent recourir au chômage intempéries – un arrêt momentané des travaux – si les conditions météorologiques mettent en danger la santé des employés. Autrement dit, la canicule peut être traitée comme un cas de force majeure tout comme une tempête ou une inondation. Ces mesures sont essentielles, mais dans la pratique, tous les salariés n’osent pas réclamer leur due. Sur certains chantiers, on s’organise officieusement : l’équipe commence dès l’aube, à 6h ou 7h, pour bénéficier de la relative fraîcheur matinale, quitte à finir plus tôt. « Les conditions de travail deviennent difficiles lorsque le thermomètre grimpe jusqu’à 39 degrés » confie un ouvrier, soulignant qu’un nouvel employé “ne tiendrait pas deux semaines” dans ces conditions extrêmes. Ce ressenti traduit l’accoutumance des anciens et la pénibilité réelle pour tous.
Heureusement, certains secteurs ont intégré historiquement cette réalité saisonnière. Dans le bâtiment, par exemple, le congé collectif obligatoire en été met chaque année les ouvriers au repos pendant environ trois semaines à partir de fin juillet. Cette pause, qui inclut traditionnellement le 15 août, tombe à point nommé pour les protéger lors des périodes souvent les plus torrides. Mais alors que le climat se dérègle, les vagues de chaleur surviennent aussi en juin ou en septembre, en dehors de ces périodes de congé planifiées. Il faudra sans doute à l’avenir plus de flexibilité et d’anticipation : pourquoi ne pas imaginer, lors des canicules, un élargissement du télétravail ou des horaires aménagés y compris pour les cols blancs, une « sieste méridienne » institutionnalisée comme dans les pays du Sud, ou d’autres adaptations du rythme de travail à la météo ? La valeur du travail ne devrait pas se mesurer au nombre d’heures passées en plein soleil quand le soleil menace la vie. Ici encore, la justice climatique implique de repenser nos habitudes – et de mettre la santé avant le productivisme, surtout quand la fournaise frappe.
Les damnés de la chaleur
La climatisation : fausse bonne solution ou nécessité vitale ?
Face à la canicule, la tentation de la climatisation est grande. Quoi de plus simple que d’allumer un climatiseur pour transformer son intérieur en oasis ? D’ailleurs, l’accès à l’air conditionné sauve déjà des dizaines de milliers de vies par an dans le monde. Des études ont montré que le risque de décès lié à la chaleur est réduit d’environ 75 % pour les foyers équipés d’un climatiseur – un écart colossal qui illustre l’importance du refroidissement artificiel pour les populations vulnérables. Dans les hôpitaux, les maisons de retraite, ou pour les femmes enceintes et personnes malades, la clim peut véritablement faire la différence entre la vie et la mort. Il est donc hors de question de s’en priver totalement : certaines catégories de personnes ont “vraiment besoin de la climatisation”, rappelle Enrica De Cian, chercheuse spécialiste de ces enjeux.
Cependant, généraliser la climatisation à grande échelle sans autre changement reviendrait à soigner un mal par un mal plus grand encore. Un « monde climatisé » où chaque pièce, chaque voiture, chaque magasin tourne au froid artificiel est un cercle vicieux pour la planète. Déjà aujourd’hui, la climatisation est responsable d’environ 1 milliard de tonnes de CO₂ par an – soit près de 3 % des émissions mondiales. Et ce chiffre explose avec la hausse de la demande. On estime à 2 milliards le nombre de climatiseurs en service sur Terre, un parc appelé à grimper en flèche avec le réchauffement et la croissance des revenus. Si chacun cherche son salut individuel en branchant un climatiseur, nous risquons d’aggraver le problème que nous tentons de fuir. D’une part, parce que la production d’électricité doit suivre – or les jours de canicule, la clim peut représenter jusqu’à la moitié du pic de consommation électrique d’une région. En période de pointe, cela signifie plus de centrales en marche, souvent fossiles, et donc plus d’émissions carbonées… D’autre part, parce que les climatiseurs rejettent de la chaleur à l’extérieur. Ils refroidissent nos salons en soufflant de l’air chaud dans la rue, contribuant ainsi à l’îlot de chaleur urbain. Des simulations ont montré qu’une ville entièrement climatisée pourrait voir sa température nocturne augmenter d’environ 1 °C à cause de ces rejets thermiques – un comble ! Ajoutons-y l’utilisation de fluides réfrigérants à effet de serre puissant, et l’on comprend que la climatisation massive, telle qu’on la pratique aujourd’hui, est une fuite en avant intenable.
Cette fuite en avant est d’autant plus injuste qu’elle laisse sur le bas-côté ceux qui n’ont pas les moyens de la clim. Installer un split ou payer des factures d’électricité alourdies n’est pas envisageable pour tous : le coût élevé empêche de nombreuses familles d’accéder à la climatisation, et même équipées, certaines doivent choisir entre se refroidir ou satisfaire d’autres besoins essentiels lorsqu’elles voient la note d’électricité grimper. Le risque, c’est une nouvelle fracture : entre ceux qui peuvent s’acheter un microclimat et ceux qui subissent les vagues de chaleur sans recours. Un apartheid thermique, en somme, si la clim devenait le seul remède.
La solution n’est évidemment pas de bannir tout air conditionné – ce serait utopique et cruel – mais d’encadrer son usage et de le combiner avec d’autres approches. D’abord, il est impératif de verdir l’électricité qui alimente ces appareils : une climatisation à base d’énergies renouvelables n’aggrave pas l’effet de serre. Ensuite, des progrès technologiques peuvent en limiter l’empreinte : climatiseurs moins énergivores, fluides frigorigènes à faible impact, normes d’efficacité strictes, et une régulation pour éviter les excès (par exemple, fixer une température de consigne minimale de 24 °C, comme le préconise l’Agence Internationale de l’Énergie). Mais surtout, la climatisation ne doit pas nous faire oublier les solutions de fond d’aménagement du territoire. Avant d’acheter un climatiseur, peut-être pouvons-nous mieux isoler nos logements pour qu’ils conservent la fraîcheur ? Planter des arbres autour des immeubles pour faire de l’ombre ? Peindre toits et trottoirs en clair pour réfléchir le rayonnement solaire plutôt que de l’absorber ? Installer des fontaines, des brumisateurs dans l’espace public, et ventiler naturellement nos rues ? Toutes ces mesures “permettent de nous refroidir de façon durable”, résume Robert Dubrow, directeur du Centre climat et santé de Yale – et « leur mise en place n’est qu’une question de volonté politique ». La véritable climatisation d’une ville, c’est finalement sa végétation, son architecture bioclimatique et la solidarité de ses habitants.
Bâtir des oasis urbaines : infrastructures et habitat à réinventer
Plutôt que de climatiser l’atmosphère, ne vaudrait-il pas mieux adapter nos espaces de vie pour qu’ils restent naturellement supportables ? La rénovation thermique des bâtiments est un levier majeur de cette adaptation socio-écologique. Longtemps, on a construit au Luxembourg en pensant surtout à se protéger du froid de l’hiver. Désormais, avec des étés à 35-40 °C, il faut aussi se protéger du chaud. Isoler un logement, ce n’est pas seulement économiser du chauffage en janvier, c’est aussi garder la fraîcheur en juillet. Des volets, des pare-soleil, une bonne ventilation nocturne peuvent faire chuter de plusieurs degrés la température intérieure. Le gouvernement l’a bien intégré : la nouvelle stratégie d’adaptation climatique impose que les constructions neuves intègrent des critères de résilience climatique, par exemple une isolation renforcée contre la chaleur et des toitures végétalisées, afin de réduire les surchauffes estivales. Mais qu’en est-il du bâti existant ? Là encore, des programmes publics encouragent la rénovation : aides financières (PrimeHouse, enoprimes, TVA réduite) pour ajouter une couche d’isolant, remplacer des fenêtres, installer une ventilation double flux. Ces investissements restent coûteux, ce qui pose la question de l’accessibilité de la rénovation pour les ménages modestes. Sans soutien accru, on risque de voir se creuser un fossé thermique entre logements riches bien rénovés et passoires énergétiques où s’entassent les moins nantis.
Au-delà des murs, c’est l’espace public qu’il faut transformer en refuge urbain face aux canicules. Chaque commune peut contribuer à créer des “îlots de fraîcheur” accessibles à tous : parcs, jardins, plans d’eau, piscines en plein air, bibliothèques climatisées ouvertes en horaires étendus lors des alertes, etc. Certaines villes européennes innovent : à Paris ou Athènes, des “refuges climatiques” (églises, musées, centres commerciaux) sont répertoriés et accessibles librement pour qui veut se rafraîchir. À Barcelone ou Münster, on installe des toiles d’ombrage au-dessus des bancs publics fréquentés par les sans-abri, pour qu’ils ne rôtissent pas en plein soleil. Le Luxembourg pourrait s’inspirer de ces bonnes pratiques. Pour l’instant, l’initiative repose souvent sur des acteurs locaux ou bénévoles (distribution d’eau, maraudes de la Croix-Rouge, etc.), mais il est temps d’institutionnaliser la solidarité face à la chaleur. Pourquoi ne pas imaginer un “droit à la fraîcheur” qui garantirait à chacun l’accès à un abri climatisé ou ventilé lors des canicules ? Après tout, on le fait bien en hiver avec les plans grand froid et l’hébergement d’urgence – l’été meurtrier mérite la même attention.
Enfin, repenser la ville face au soleil brûlant suppose de retrouver une vision de long terme dans l’aménagement. L’adaptation climatique n’est pas qu’une affaire d’écologistes, c’est un chantier transversal qui touche la santé, l’économie, la cohésion sociale. Le Luxembourg s’est doté en 2018 d’une Stratégie et plan d’action pour l’adaptation (actualisée en 2025 avec 131 mesures). Parmi ces mesures phares se trouvent la collecte de données en temps réel sur les maladies liées à la chaleur, le développement d’infrastructures vertes en ville pour atténuer les canicules, ou encore la mobilisation des entreprises dans la résilience climatique. Il est encourageant de voir un État anticiper ainsi les crises à venir. Mais une stratégie, si ambitieuse soit-elle, doit se traduire sur le terrain par des actes concrets et surtout par une approche inclusive. Qui bénéficie de ces aménagements ? Si on végétalise uniquement les beaux quartiers et les centres-villes vitrine, on laissera en plan les zones périurbaines où vivent souvent les classes populaires et les personnes âgées sans moyens de déménager. L’égalité d’accès à la fraîcheur doit devenir un impératif d’aménagement du territoire, tout comme l’est l’égalité d’accès à l’eau ou à l’énergie. Créer un square arboré dans un lotissement de HLM, c’est potentiellement sauver des vies lors de la prochaine vague de chaleur, autant que de planter un énième parc dans un quartier déjà favorisé. La justice climatique, à l’échelle locale, se joue dans ces arbitrages.
Imaginaire et justice : bifurquer vers un futur habitable
Derrière nos réponses à la chaleur se cachent enfin des imaginaires qu’il convient d’interroger. Quelle vision du progrès guide nos choix ? Avons-nous normalisé l’idée qu’un été étouffant est inéluctable et qu’il suffit de s’enfermer chacun chez soi avec l’air conditionné ? Ou pouvons-nous rêver d’un monde où, même en plein mois d’août, marcher en ville reste agréable, où personne n’est contraint de dormir dans un logement à 30 °C la fenêtre ouverte sur la pollution et le vacarme ? L’imaginaire dominant d’une société high-tech a longtemps sous-estimé la matérialité de la crise climatique. Il nous murmurait que pour chaque problème, la technique apporterait une solution miraculeuse – ici un climatiseur pour vaincre la canicule, là un mégaprojet de géo-ingénierie pour refroidir la planète. Or cette approche technosolutionniste a montré ses limites : elle dissimule les injustices (puisque seuls certains ont accès aux solutions) et aggrave parfois le mal (par les effets rebond sur l’environnement). À l’inverse, un imaginaire de renoncement, prônant la souffrance stoïque ou le retour à la bougie, ne saurait convenir non plus. La bifurcation écologique à laquelle nous appelle la crise climatique n’est ni un refus de la technologie, ni une foi aveugle en elle. Il s’agit plutôt de mettre la technique au service du bien commun et de la combiner avec la sagesse des solutions sobres.
Cette bifurcation écologique, concrètement, signifie changer de cap rapidement et radicalement pour sortir du piège de la chaleur subie. Cela passe par une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre – domaine dans lequel le Luxembourg a une responsabilité particulière, étant l’un des plus gros émetteurs par habitant d’Europe (17,6 tonnes de CO₂e par an, soit plus du double de la moyenne européenne). Le Grand-Duché, riche et innovant, se doit d’être exemplaire en matière de sobriété énergétique et de transition vers les renouvelables, afin de contribuer à limiter le réchauffement global. Chaque dixième de degré compte : les projections montrent qu’au-delà de +1,5 °C (seuil que l’Europe pourrait franchir dès 2027), les canicules deviendront si fréquentes et intenses que nos capacités d’adaptation seront débordées. Autrement dit, adapter nos sociétés ne suffira pas si nous ne combattons pas en parallèle la cause du mal. Justice climatique globale oblige, un pays comme le Luxembourg – dont l’empreinte carbone historique et le niveau de vie sont élevés – doit faire sa part pour épargner aux populations les plus pauvres du monde l’enfer thermique qui se profile. Les « damnés de la chaleur », ce sont aussi ces millions de gens, du Sahel à l’Inde, qui subissent déjà des températures invivables sans ressources pour s’en protéger.
Au niveau local, bifurquer écologiquement implique de placer la justice sociale au cœur des politiques climatiques. Cela signifie par exemple aider prioritairement les foyers modestes à équiper ou isoler leur logement, garantir l’accès de tous aux infrastructures de rafraîchissement (parcs, piscines, bâtiments climatisés), protéger les travailleurs exposés même si cela bouscule l’organisation du travail traditionnelle, et encourager des modes de vie plus résilients (horaires d’été aménagés, entraide de voisinage, etc.). Il s’agit de renforcer les communs – ces ressources partagées que sont l’air, l’eau, l’ombre des arbres – pour qu’aucun individu ne soit laissé seul face au soleil brûlant. Il s’agit aussi de raconter d’autres récits : célébrer celles et ceux qui plantent des forêts urbaines, qui inventent des matériaux refroidissants, qui repensent la ville comme une oasis et non un désert de béton. Ces récits nourrissent l’espoir et l’action collective, là où le fatalisme ne propose que l’inaction.
En ce sens, la chaleur extrême est un défi éminemment politique et poétique à la fois. Poétique, parce qu’elle nous force à retrouver l’humilité devant le climat, à écouter les battements du soleil et de la terre, à imaginer de nouvelles façons d’habiter nos étés. Politique, parce qu’elle exige des décisions courageuses aujourd’hui pour éviter des hécatombes demain. Dans la fournaise de juillet, une société révèle ce qu’elle valorise : va-t-elle protéger les plus fragiles ou les sacrifier sur l’autel du statu quo ? Va-t-elle s’adapter dans la solidarité ou dans le chacun-pour-soi climatisé ? Les damnés de la chaleur n’ont pas vocation à le rester : en faisant de la justice climatique notre boussole, nous pouvons transformer l’épreuve en occasion de solidarités nouvelles. L’été n’a pas à être l’enfer des uns pendant qu’il demeure le doux farniente des autres. À nous de construire, dès maintenant, la ville et la société où chaque vague de chaleur trouvera face à elle une vague de fraîcheur humaine et écologique. C’est à ce prix que nos étés resteront vivables et partagés par tous, plutôt que maudits par une partie de nos semblables. En somme, face au soleil ardent, à nous d’écrire une histoire collective où personne n’est damné de la chaleur.
Auteur: Tarik Bouriachi
